Face à la Russie, la dissuasion française vers un réarmement majeur ?
Pour protéger l’Europe, la France réfléchit à renforcer ses forces de dissuasion. Avec une augmentation du nombre de têtes nucléaires…
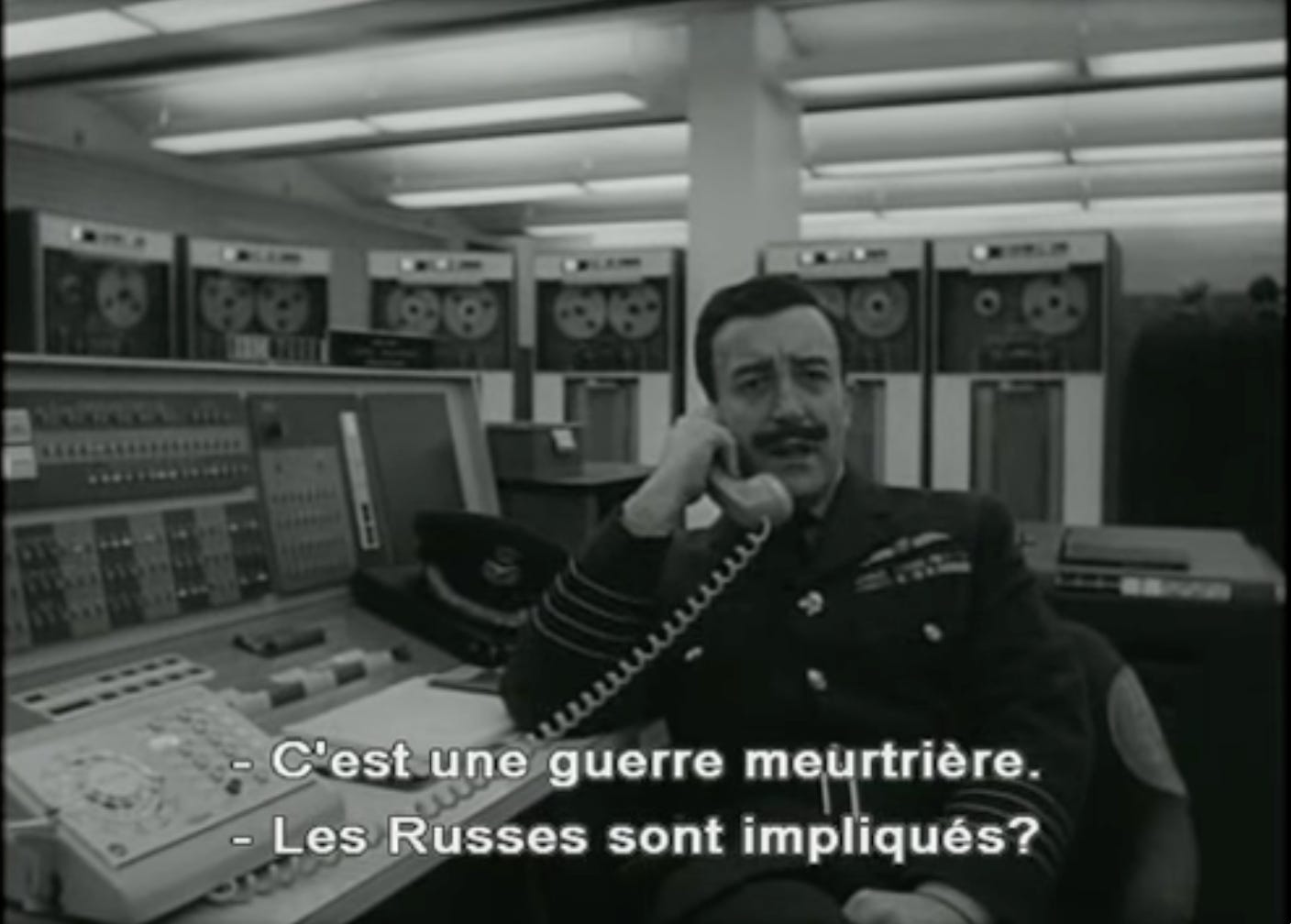
Seul pays de l’Union Européenne à avoir « la bombe », la France peut-elle donner une garantie nucléaire à ses voisins et ses alliés ? En a-t-elle au moins les capacités ? Surtout, ses adversaires la jugerait-elle crédible ? Il a suffi que Donald Trump montre une nouvelle fois que la sécurité de l’Europe était le cadet de ses soucis pour que toutes ces questions surviennent dans la tête des gouvernants européens. Le 21 février 2025, à la veille des élections fédérales en Allemagne, le candidat menant la liste CDU-CSU, Friedrich Merz, estime ainsi que la dissuasion nucléaire française et britannique peut « être utilisée par l’Allemagne ». Dix jours plus tard, le 5 mars 2025, Emmanuel Macron répond « à l’appel historique du futur chancelier allemand » en affirmant avoir « décidé d’ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen ».
Un mois et demi après, le journaliste Darius Rochebin interroge le président français pour savoir si la France pourrait stationner, comme le font les Américains dans le cadre de l’OTAN, des armes nucléaires sur le sol de nos alliés européens, et ce dernier répond : « nous sommes prêts à avoir cette discussion ». Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron évoque l’idée d’une « dimension européenne » de la dissuasion nucléaire française. En février 2020, lors d’une allocution à l’École de guerre alors peu commentée, Emmanuel Macron avait commencé à franchir un pas dans ce sens en appelant à un dialogue stratégique avec les partenaires européens sur le rôle de la dissuasion française pour la stabilité du continent. Il ne proposait pas de mise en commun ni de partage des moyens, mais ouvrait néanmoins la voie à une évolution doctrinale : l’élargissement du périmètre des intérêts nationaux.
« Soyons clairs : les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne ». À l’époque, cette déclaration du président français avait suscité indifférence et scepticisme à Berlin. Précédemment, ses discours enflammés à Athènes ou à la Sorbonne pour la « souveraineté européenne », une « Europe de la Défense », ou « l’autonomie stratégique » du continent avaient été considérés avec un dédain certain dans les capitales européennes.
Il faudra attendre l’automne 2019 et son interview à The Economist dans laquelle il estime que l’OTAN se retrouve en « état de mort cérébrale », pour qu’Emmanuel Macron réussisse à susciter des réactions (la plupart négatives) sur ses propositions. À l’époque, l’Allemagne n’était pas encore prête : avec sa Constitution pacifiste, sa dépendance à l’égard du « parapluie nucléaire » américain, sa culture stratégique fondée sur le désarmement, mais aussi sa peur d’un leadership renforcé de Paris.
Quand Chirac voulait protéger le « territoire européen »
Pour mon livre l’Emprise, j’avais interrogé son prédécesseur, François Hollande. L’ancien président semblait sceptique lui aussi, et me rappelait un fait qui lui semblait indépassable : « Ni la France ni l'Allemagne ne sont prêtes à une codécision en matière de dissuasion nucléaire ». On le verra plus loin, mais toute idée de « codécision » n’est tout simplement pas envisageable en matière de dissuasion nucléaire.
Reste qu’en ce printemps 2025, le changement de décor est total. À Berlin, conservateurs et sociaux-démocrates ont scellé un accord de coalition qui tourne le dos à l'orthodoxie budgétaire et au pacifisme hérités de l'après-guerre. Parmi les responsables politiques français, cette inflexion majeure et unilatérale suscite peu de commentaires ou même de débat. Vogue la galère !
Pour autant, Emmanuel Macron n’a pas toujours eu cette « foi » dans le feu nucléaire. Comme je l’ai déjà raconté, au printemps 2010, lors d’une séance de travail de la seconde commission Attali, le jeune banquier d’affaires expose aux membres présents une proposition osée : rien de moins que de supprimer la force de dissuasion nucléaire pour faire des économies. Très vite, Jacques Attali, ancien conseiller spécial de François Mitterrand, interrompt sèchement son protégé pour le contredire. Les autres membres de la commission renchérissent : pas question de supprimer la dissuasion, outil majeur de l'influence française dans le monde.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un président français propose de faire de la dissuasion nucléaire une composante essentielle de la défense européenne. Bien avant Macron, Giscard, Mitterrand et Chirac… ont tous déjà évoqué la « dimension européenne » de la bombe française. Dans son discours du 8 juin 2001 à l’IHEDN, Jacques Chirac explique ainsi : « J'évoquais tout à l'heure le développement par certains États de capacités balistiques qui pourraient leur donner les moyens, un jour, de menacer le territoire européen avec des armes nucléaires, biologiques ou chimiques. S'ils étaient animés d'intentions hostiles à notre égard, les dirigeants de ces États doivent savoir qu'ils s'exposeraient à des dommages absolument inacceptables pour eux ». Même le général De Gaulle écrivit dans une « instruction personnelle et secrète », adressée en 1964 aux chefs des armées et aux responsables des forces nucléaires, que « la France doit se sentir menacée dès que les territoires de l'Allemagne fédérale et du Benelux seraient violés ».
Le feu nucléaire comme nouvelle ligne d’horizon
Jusqu’à récemment encore, tous ces discours des présidents français sur la dissuasion nucléaire étaient peu commentés. L’idée que l’Europe ne puisse plus être protégée par le « grand frère » américain n’était même pas envisagée. Pour beaucoup, la Pax Americana d’après guerre froide semblait immuable.
L’émergence de la Chine et de puissances extra-occidentales depuis une quinzaine d’années bouleverse l’ordre mondial. De fait, on assiste au grand retour du nucléaire comme cœur des relations de puissance. Les opinions publiques occidentales ont eu tendance à l’oublier après la fin de la guerre froide, mais le feu nucléaire apparaît de nouveau comme une ligne d’horizon possible de la guerre.
Après le grand désarmement des années 1990, les États nucléaires se sont mis peu à peu à se réarmer à travers la modernisation de leurs arsenaux : « Nous vivons actuellement l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité », a mis en garde Dan Smith, directeur du Sipri, un centre de recherche suédois qui publie régulièrement des rapports sur la situation du nucléaire militaire dans le monde. Rappelons qu’en 2024, il y avait 12 121 ogives nucléaires existantes dans le monde, 9 585 étaient disponibles en vue d'une utilisation potentielle et 2 100 d'entre elles étaient maintenues en état d'« alerte opérationnelle élevée » pour les missiles balistiques.
À marche forcée, la Chine rattrape son « retard », disposant désormais de 600 têtes nucléaires selon le Pentagone, et la puissance asiatique pourrait dépasser le millier d’ogives en 2030. Depuis quelques années, les signaux se multiplient sur ce qui s’apparente à un véritable réarmement. Plus alarmant encore, ce sont les équilibres stratégiques traditionnels qui sont aujourd’hui remis en question. On assiste au retour de la menace nucléaire, à la résurgence du risque entre puissances nucléaires.
Le 2 août 2019, les États-Unis décident ainsi de ne plus participer au traité INF signé en 1987 qui réglementait les missiles à portée intermédiaire en Europe. Dans les jours qui suivent, la Russie procède au test d’un nouveau missile pouvant porter des ogives nucléaires et le fait savoir. En février 2023, la Russie suspend sa participation au traité New Start, dernier accord de maîtrise des armements liant Washington à Moscou. Ce traité doit arriver à expiration en février 2026, et limite chaque partie à 1 550 ogives stratégiques offensives déployées et prévoit un mécanisme de vérifications (interrompues depuis la suspension russe d’il y a deux ans).

La France maîtrise l’ensemble de la chaîne nucléaire
Dans ce contexte, la France est le seul pays de l’Union Européenne à disposer d’une force nucléaire complète, opérationnelle, indépendante et modernisée. À travers la très secrète Direction des Applications Militaires (DAM), rattachée au CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), la France est l’un des rares États à maîtriser l’ensemble de la chaîne du nucléaire militaire : de la recherche fondamentale à la simulation, de la propulsion à la dissuasion.
Ces forces nucléaires sont souvent vues comme le dernier rempart de l’indépendance nationale. La France n’a d’ailleurs jamais voulu intégrer ses forces nucléaires à une organisation multilatérale. Et si le pays fait de nouveau partie depuis 2009 du commandement intégré de l’OTAN, qui est avant tout une alliance nucléaire, sa force de dissuasion, présentée comme « tous azimuts », c’est-à-dire valable contre toute puissance susceptible de menacer la France, reste extérieure à la planification stratégique de l’organisation atlantique. La France n’a jamais admis que sa dissuasion puisse être subordonnée à une logique étrangère, et s’était fortement opposée à la stratégie américaine de la « riposte graduée » développée à partir de 1962 dans le cadre de l’OTAN. On ne s’en souvient guère mais cette « riposte graduée » envisageant un éventuel champ de bataille nucléaire en Europe avait déjà fait douter de l’effectivité d’un « parapluie » américain », et d’un partage réel de la dissuasion.
Au cœur de la doctrine française, on trouve ainsi le principe de dissuasion du faible au fort. L’idée est simple : la possibilité de riposter avec une intensité inacceptable suffit à décourager toute velléité de chantage ou d’agression. C’est une sorte de judo stratégique. Car cette doctrine est fondée sur le renversement des forces. L’effet recherché n’est pas la destruction mutuelle assurée mais l’élévation du coût de l’agression à un niveau insupportable.
Deux autres grands principes guident la doctrine française de dissuasion. D’abord, l’autonomie de décision : la dissuasion est placée sous le contrôle exclusif du président de la République. Et ensuite, la « stricte suffisance » : le fait de garantir en permanence la possibilité de causer des dommages inacceptables à tout agresseur potentiel, quelles que soient les circonstances (y compris en cas d’attaque surprise adverse). À l’origine, il ne s’agit donc pas, pour la puissance moyenne qu’est la France, de tenter de rivaliser symétriquement avec l’URSS, mais de développer un arsenal dont le volume et les propriétés techniques et opérationnelles décourageraient même une superpuissance de s’en prendre directement à ses intérêts vitaux. À l’origine, cette approche française exclut l’accumulation d’armes ou la recherche de la suprématie stratégique. Si durant la guerre froide, la France a pu stocker jusqu’à 540 têtes nucléaires, elle dispose aujourd’hui de la moitié (290).
Les forces nucléaires françaises en format réduit
En réalité, la doctrine française de dissuasion a évolué en fonction des présidents et des évolutions technologiques. Dans les années 1990, il est ainsi décidé la contraction du format des forces et du complexe de conception et de production des armes nucléaires françaises. La France ferme, puis démantèle le polygone de test situé en Polynésie française, signe et ratifie le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Elle ferme également, puis démantèle, ses sites de production de matières fissiles de Marcoule et Pierrelatte. Diplomatiquement, la France s’engage dans la voie du désarmement international, en prenant désormais une part active dans la lutte contre la prolifération nucléaire (En 1992, elle ratifie ainsi le TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires).
En 1995, Jacques Chirac décide également de se passer d’une des composantes de la dissuasion, les missiles nucléaires sol-sol, avec la suppression du célèbre plateau d’Albion, leur base de lancement. Le nombre de sous-marins nucléaires porteurs de missiles balistiques de la Force océanique stratégique (FOST) passe de 6 à 4, et le nombre d’escadrons des bombardiers des Forces aériennes stratégiques (FAS) passe de 5 à 3, (puis à 2 à la fin des années 2000).
C’est également à ce moment-là que la France décide de ne plus différencier les frappes dites « tactiques » des frappes dites « stratégiques ». Autrement dit, la France s’engage à ce que son arme nucléaire ne puisse être utilisée qu’en dernier recours, dans le cadre d’un rapport de force nécessairement stratégique et s’inscrivant pleinement dans la dissuasion (et donc dans sa dimension défensive).
Ce que le grand public ne perçoit pas forcément, c’est que cette doctrine française n’est pas forcément partagée par l’ensemble des puissances nucléaires, notamment la Russie ou de nouveau les États-Unis… Comme on le verra plus loin.
Par la suite, Nicolas Sarkozy décide en 2008 de réduire d’un tiers la composante nucléaire aéroportée (les missiles embarqués par les avions) avec l’entrée en service d’un nouveau missile air-sol plus performant. L’arme nucléaire est une « arme de légitime défense », comme il le déclare lors d’un déplacement à Cherbourg en 2008. Quant à lui, François Hollande réduit un peu plus l’ambiguïté stratégique de la dissuasion française, en annonçant cibler prioritairement les centres de pouvoir, lors de son discours sur la base aérienne d’Istres, tout en insistant sur la nécessité de la permanence du dispositif. On le voit, poursuivant le principe de « stricte suffisance », la France profitait jusqu’à présent des avancées technologiques pour adapter ses forces (et maîtriser les coûts au passage).
Modernisation des armes et nouveaux sous-marins
Si la France ne participe pas à la course aux armements, elle est soucieuse de préserver sa permanence technologique. En effet, faute d’investissements, une dissuasion nucléaire peut vite devenir obsolète. C’est pourquoi à partir des années 2010, l’État décide d’augmenter à bas bruit ses investissements dans ce domaine. Un effort confirmé par Emmanuel Macron. Dans la dernière loi de programmation militaire (2024-2030), la dissuasion nucléaire représente désormais un budget de 5 à 6 milliards d’euros par an (soit 13 % du budget total des armées). Au regard de l’intensité des investissements, c’est finalement des coûts maîtrisés, d’autant si l’on compare aux dérives récentes aux États-Unis avec les coûts astronomiques des nouveaux bombardiers stratégiques B21 ou des Sentinel ICBM, ou certaines impasses russes (rhétorique de l’escalade compensant la dégradation des arsenaux).

Ce nouveau cycle de rénovation de la force nucléaire française passe d’abord par la mise en chantier par la DGA (Direction générale de l’Armement), le CEA et Naval Group d’une troisième génération de sous-marins SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d'engins), qui doivent prendre le relais à partir de 2035. Des investissements importants sont notamment consacrés à l’amélioration de la discrétion acoustique de ces nouveaux SNLE pour les rendre plus furtifs. Tout a été repensé : coque, propulseur, système de navigation, senseurs (capteurs), l’intelligence artificielle embarquée. L’objectif ? Garantir l’invisibilité totale, y compris face aux futures générations de détection multi-domaines (quantique, gravimétrique, thermique), tout en réduisant l’empreinte logistique et énergétique. Ce programme mobilise des milliers d’ingénieurs et s’étend sur plus de trente ans.
Mais d’autres investissements sont prévus. Car l'un des enjeux les plus importants pour maintenir la crédibilité de la dissuasion est de pouvoir en permanence s'assurer que les forces nucléaires françaises pénétreraient ou satureraient les défenses adverses (défenses antimissiles et antiaériennes). Il s’agit ainsi de préserver les capacités de pénétration des futures versions du missile balistique mer-sol M-51 face au renforcement des capacités de défense antimissile dans le monde.
Le surgissement des armes hypersoniques
Plus globalement, il s’agit de faire face à tout risque de surprise technologique. Ainsi, le surgissement des armes hypersoniques, qui ont été utilisées pour la première fois à partir de 2022 par la Russie dans le cadre de sa guerre en Ukraine, entraîne un changement brutal dans l'équilibre stratégique mondial. Alliant une vitesse inédite –Mach 5 (plus de 6.000 km/h, soit 5 fois la vitesse du son) – à une manœuvrabilité exceptionnelle, les missiles hypersoniques sont particulièrement délicats à intercepter pour les défenses antimissiles existantes.
Dans ce domaine de l’hypervélocité, les trois plus grandes puissances nucléaires (Russie, États-Unis, Chine) se livrent une compétition féroce. Si la Russie possède une certaine avance avec des systèmes comme l’Avangard, le Kinzhal ou encore le Zircon, la Chine développe aussi ses armes hypersoniques (DF-2F, YJ-21), et les États-Unis mettent les bouchées doubles pour combler leur retard (C-HGB).
Ces missiles hypersoniques, capables de manœuvrer à des vitesses supérieures à Mach 5 dans les couches atmosphériques denses, bouleversent les temps de réaction, la nature des trajectoires, et la capacité de riposte anticipée. Le principal effet stratégique de ces armes n’est pas la puissance de destruction, mais la réduction drastique du temps de décision pour les États visés, et la difficulté croissante à distinguer entre frappe conventionnelle et frappe nucléaire. Cela entraîne un risque d’alerte prématurée, de mauvaise interprétation ou d’escalade incontrôlée.
Face à ce bouleversement technologique, et pour combler son retard, la France a décidé d’engager toutes ses forces dans son propre programme de missiles hypersoniques, en développant l’ASN4G (Air-Sol Nucléaire 4e génération), successeur du missile ASMP-A actuellement en service (Mach 3/4). L’enjeu de ce programme est double : garantir la pénétration dans les espaces hautement défendus (A2/AD – Anti-Access/Area Denial) et introduire une capacité de vitesse hypersonique (supérieure à Mach 5), rendant toute interception pratiquement impossible.
À terme, l’ASN4G, combiné au Rafale F5, représentera une arme de frappe stratégique à haute manœuvrabilité, capable de répondre à la prolifération de systèmes de défense avancés (S-500 russes, HQ-19 chinois) et de systèmes de guerre électronique. La mise en service opérationnelle de cette arme redoutable, conçu par le groupe MBDA en collaboration avec la DAM/CEA est pour l’instant prévue autour de 2035. Les premiers essais de maquette, de matériaux, de guidage inertiel et de propulsion sont en cours.
Il est donc vital de maintenir l’efficacité de pénétration de l’arme nucléaire française vis-à-vis des défenses adverses pour conserver la crédibilité de dissuasion du pays. Cette capacité de pénétration s’obtient à la fois par la vitesse et la manœuvrabilité des vecteurs utilisés mais également par leur furtivité — permettant qu’ils soient détectés le plus tard possible — et aussi par leur nombre.
Vers une augmentation de l’arsenal nucléaire français
Seuls les spécialistes en sont conscients, mais il est nécessaire de disposer d’un nombre suffisant de têtes nucléaires à mobiliser dans une attaque nucléaire pour espérer échapper aux défenses adverses. Au cœur de la guerre froide, c’est la raison pour laquelle Américains et Russes se sont mis à développer dans leurs arsenaux des ogives nucléaires à têtes multiples ou M.I.R.V. (Multiple Independently targetable Re-entry Vehicle). En accédant à la miniaturisation, la France a pu également accéder à cette « avancée » technologique dans les années 1980 et a équipé d’ogives à têtes multiples les missiles mobilisés dans ses sous-marins.
À tout moment, la France doit donc adapter son système à sa posture nucléaire. Est-ce que l’équilibre de destruction est encore respecté ? La question se pose notamment quand les capacités de défense évoluent. Quel est l’état des forces chez les autres puissances ? « On regarde en permanence l’état du stock », me rappelle un spécialiste du sujet. Élargir le périmètre des intérêts vitaux de la France à d’autres pays européens amène forcément la DAM, et sa direction des armes nucléaires, à envisager une augmentation du nombre de têtes dans l’arsenal français. Selon mes informations, des réflexions sont bien en cours sur une augmentation éventuelle du nombre de têtes.
Après vingt ans de contraction des forces nucléaires, on assiste donc, derrière les discours présidentiels, au retour à un réarmement nucléaire qui va bien au-delà de la modernisation précédemment décrite. Parmi les experts, tous ne sont pas convaincus d’une telle nécessité stratégique (à lire notamment cet article : « Le parapluie et la panique : les fausses évidences sur la renucléarisation et la remilitarisation de l’Europe »), mais bon nombre d’entre eux estiment, en off ou publiquement, que la France, avec l’affaiblissement des garanties américaines, devra augmenter tôt ou tard son arsenal nucléaire (290 têtes) face à la menace russe (près de 1600 têtes déployées) : « Le dogme de la stricte suffisance doit (…) être questionné, estime ainsi Benoît Grémare, ancien officier à l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque, Si aujourd’hui, 290 têtes nucléaires représentent la valeur que la France accorde à la défendre de son existence, ce prix paraît négliger l’échelle du continent européen, et la logique le confirme : les puissances nucléaires de taille continentale telles que les États-Unis, la Russie et bientôt la Chine déploient un arsenal à hauteur d’un millier de têtes thermonucléaires ». De son côté, Étienne Marcuz de la FRS (Fondation pour la recherche stratégique) estime qu’il sera bientôt nécessaire pour la France d’avoir deux sous-marins SNLE à la mer en permanence, et pas seulement un seul comme actuellement.
C’est dans cette perspective de réarmement que la France envisage ainsi, comme l’a dévoilé début juin La Tribune, de s’appuyer sur la centrale EDF de Civaux mais aussi sur le réacteur militaire RES installé sur le site du CEA à Cadarache (Bouches-du-Rhône) pour produire de nouveau du tritium, composant essentiel dans la fabrication de bombes H. Depuis l’arrêt du site de production de Marcoule en 2009, l’État s’appuie sur un stock existant de tritium, dont le volume reste confidentiel. Or, le tritium est un gaz qui « se désintègre et disparaît spontanément », indique une note explicative du ministère des Armées, publiée au printemps 2024 lors de l'officialisation de la collaboration entre l'État et EDF. « Tout stock est réduit de moitié au bout de 12 ans, les trois quarts au bout de 25 ans, 99,5 % au bout d'un siècle...Impossible de produire le tritium une fois pour toutes et de le stocker », précise le document. Il faut donc en fabriquer régulièrement, ce qui explique la décision soudaine de l’État français d’en reproduire.
Quelle place pour l’arme nucléaire française en Europe ?
La crédibilité d’une force nucléaire ne repose pas uniquement sur la possession d’armes mais aussi et surtout sur la démonstration permanente que ces armes sont opérationnelles, impossibles à neutraliser et prêtes à l’emploi en toutes circonstances. Les évolutions technologiques contemporaines viennent brouiller les frontières traditionnelles entre dissuasion stratégique et action tactique, entre théâtre conventionnel et menace existentielle. Armes hypersoniques, cyberguerre, guerre hybride, interférences spatiales… À court terme, de nombreux sujets pourraient ainsi être partagés entre la France et d’autres pays européens pour assurer la crédibilité de la dissuasion française : cybersécurité nucléaire, protection des communications présidentielles, blindage électromagnétique contre les attaques informatiques.
À l’inverse, aucune codécision n’est possible dans l’emploi de l’arme nucléaire française. Entre le processus délibératif européen et la nécessité d’une décision solitaire et immédiate, rien n’est plus incompatible. De fait, la dissuasion repose sur la menace d’emploi, instantanée, crédible et univoque. Tout partage de la décision aboutirait à une dilution. Toute gouvernance partagée annulerait l’effet de la dissuasion.
La question est plutôt de définir le rôle de la dissuasion française dans la sécurité européenne élargie. Comment reconnaître le feu nucléaire français comme élément structurant de la sécurité européenne ? Car jusqu’à présent, l’espace stratégique européen était informe, divisé et sous la dépendance américaine.
Si l’Union Européenne est une puissance économique majeure, elle n’a aucune doctrine stratégique unifiée. Les Constitutions de certains États (Allemagne, Autriche, Irlande) interdisent toute adhésion à une doctrine de dissuasion. D’autres (France, Pologne), affirment la nécessité d’un feu souverain. Le traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté à l’ONU et soutenu par plusieurs membres de l’UE, s’oppose à toute reconnaissance de l’arme. De surcroît, il n’existe aucun consensus au sein de l’UE sur ce qui constituerait un casus belli, une menace existentielle, ni même sur les critères d’emploi nucléaire.
Comme le président Macron l’a proposé, cette discussion pourrait être initiée à travers un « dialogue stratégique » entre États volontaires. Plutôt que de « partager » cette arme, l’Union européenne pourrait concourir à sécuriser l’environnement stratégique de cette arme. De fait, la France ne peut porter seule le poids de la modernisation permanente. Aujourd’hui, les industriels allemands TKMS et Rohde & Schwarz et le groupe italien Leonardo, voire certains partenaires scandinaves ou néerlandais, participent déjà à des segments technologiques de la dissuasion nucléaire sous pilotage français strict, sans jamais avoir accès à la logique d’ensemble.
Le précédent de l’accord Teutates avec le Royaume-Uni
Par ailleurs, le Royaume Uni et la France ont signé ensemble l’accord Teutates, suite aux accords de Lancaster House de 2010, qui a permis de développer entre les deux pays une coopération sur des installations communes hydrodynamique et radiative, notamment sur le site de la DAM à Valduc en Bourgogne. Par ailleurs, toujours dans ce cadre, des rapprochements industriels ont été initiés entre la France et le Royaume-Uni avec MBDA sur des systèmes d’armes communs, des missiles classiques. Alors que la dissuasion nucléaire britannique est historiquement entre les mains des Américains, les Anglais cherchent aujourd’hui à développer les rapprochements avec les Français pour tenter de s’autonomiser un peu de l’Oncle Sam.
De nombreux autres projets participant à la dissuasion pourraient être soutenus par les pays européens. Jusqu’à présent, la France s’est engagée seule dans le programme de missile hypersonique ASN4G, mais plusieurs coopérations discrètes avec l’Allemagne et l’Italie ont été initiées dans ce cadre sur les matériaux (alliages thermorésistants, céramiques), mais aussi sur la navigation inertielle et le guidage adaptatif.
De même, dans le domaine de la détection, la France, seule, ne dispose pas encore d’un système complet d’alerte spatiale infrarouge équivalent au SBIRS américain ou aux satellites russes Oko. C’est pourquoi elle participe avec l’Allemagne, l’Italie et la Suède à des programmes de codéveloppement de capteurs spatiaux, de radars… Car l’arme nucléaire dépend aujourd’hui du spatial : sans contrôle autonome de l’espace, toute dissuasion devient aveugle.
Ces dispositifs de défense pourraient être particulièrement utiles dans un monde où l’on assiste à un affaiblissement des principes de la dissuasion nucléaire. À travers la guerre en Ukraine, la Russie n’a pas hésité à utiliser la menace nucléaire comme outil de coercition, loin des principes de la dissuasion à la française. Pour Vladimir Poutine, tout est bon pour intimider les capitales occidentales : les tirs et redéploiements de missiles à capacité nucléaire, le nombre croissant d’exercices impliquant les forces stratégiques, la propagande valorisant les capacités nucléaires russes, enfin, les patrouilles de bombardiers stratégiques à long rayon d’action opérant à proximité des côtes d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord, du Japon.
La France s’oppose au nucléaire sur les champs de bataille
Plus inquiétant encore, la miniaturisation des armes apporte de nouveaux périls. Ces dernières années, tout indique un retour aux ogives à faible puissance, dites charges « tactiques », pouvant être utilisées sur un champ de bataille. L’expert des armes de destruction massive, Joe Cirincione pointe dans un article de Responsible Statecraft l'évolution de la doctrine russe de dissuasion nucléaire vers cet usage, mais rappelle également que, même aux États-Unis, certains experts de la défense sont devenus des promoteurs zélés d'un tel recours. Il cite notamment l'activisme dans ce domaine de Frank Miller, un haut cadre du Pentagone, un temps conseiller du président George W. Bush. Au détour de cet article, on apprend ainsi que les États-Unis ont décidé depuis une décennie d'intégrer les armes nucléaires tactiques au sein de l'arsenal utilisable dans les plans de guerre conventionnelle.
Les promoteurs de telles armes nucléaires «tactiques» semblent indifférents à leur potentiel destructeur. À partir de 2018, l'administration Trump décide ainsi d'adapter les ogives W76 dans une version de « faible puissance», de 5 à 7 kilotonnes. En comparaison, Little Boy, lancée sur Hiroshima, avait une puissance entre 13 et 16 kilotonnes; ou, plus frappant encore, la bombe conventionnelle (donc non nucléaire) la plus puissante actuellement incluse dans l'arsenal américain, surnommée « la mère de toutes les bombes », la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, ne représente que 11 tonnes de TNT, soit un cinquantième de la puissance de ces nouvelles bombes nucléaires américaines à « faible puissance ». Autant dire que l’utilisation de ces armes nucléaires « tactiques » auraient des conséquences terribles.
Ces ogives de « faible puissance », appelées « W76-2 », commencent à être discrètement fabriquées par les États-Unis en janvier 2019. La décision suscite de nombreuses critiques (feutrées) dans la communauté de la défense américaine. Six mois après le lancement de la production de ces armes, la commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis en interdit le déploiement... Un blocage de courte durée : dès février 2020, les États-Unis annoncent avoir installé cette arme à bord d'un sous-marin, en réponse au développement par la Russie d'armements similaires. « L'US Navy a déployé la tête nucléaire de faible puissance W76-2 sur un missile balistique lancé depuis un sous-marin », indique succinctement John Rood, le numéro deux du Pentagone.
Selon Washington, Moscou est alors en train de moderniser un arsenal de 2 000 armes nucléaires tactiques, menaçant les pays européens à leurs frontières, et contournant ses obligations liées au traité de désarmement New Start, qui ne comptabilise que les armes stratégiques servant de fondement à la doctrine de dissuasion, basée sur la « destruction mutuelle assurée ». En déployant ces nouvelles armes nucléaires tactiques, Moscou pourrait « reprendre l'avantage sur les Occidentaux en cas de conflit », rapporte la dépêche AFP publiée à l'occasion. À quelques semaines du premier confinement anti-Covid-19 en France, cette information ne retient l'attention ni des médias ni des responsables politiques.
En février 2020, le président Emmanuel Macron rappelle pourtant dans son discours à l'École de guerre que la France « a toujours refusé que l'arme nucléaire puisse être considérée comme une arme de bataille ». Il affirme alors que Paris « ne s'engagera jamais dans une bataille nucléaire ou une quelconque riposte graduée ».
Pour aller plus loin :
« Forces nucléaires françaises : quel renouvellement ? », Corentin Brustlein, Politique Étrangère, automne 2017.
Sur ce dossier de la dissuasion nucléaire, à voir également la fin de mon dernier entretien sur Thinkerview (10 mars 2025) : à partir de 2h59 sur la dissuasion britannique et les accords de Lancaster avec la France, à partir de 3h07, sur les questions d’équilibre stratégique entre les États-Unis et la Russie et la place de la France et de l’Europe dans cet affrontement, à partir de 3h16, sur les problématiques de prolifération, avec un topo sur la situation de l’Ukraine depuis le non respect du memorandum de Budapest, et sur les différences de traitement de l’Iran par les États-Unis et Israël, et à partir de 3h30, sur la permanence du parapluie nucléaire américain en Europe alors que l’objectif numéro un des États-Unis est désormais la Chine :
Enfin, la bande annonce de « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick :






En matière d'hypersonique, les Russes ont 15 ans d'avance, ne les perdront pas et détiennent donc la suprématie stratégique. Augmenter le nombre de têtes nucléaires ne servira à rien puisque l'hypersoniques rajoute un étage de dissuasion supplémentaire entre le conventionnel et le nucléaire...
Quant aux têtes tactiques, la doctrine russe ne prévoit leur usage que dans un cadre strictement défensif.
"Ces missiles hypersoniques, capables de manœuvrer à des vitesses supérieures à Mach 5 dans les couches atmosphériques denses, bouleversent les temps de réaction, la nature des trajectoires, et la capacité de riposte anticipée. Le principal effet stratégique de ces armes n’est pas la puissance de destruction, mais la réduction drastique du temps de décision pour les États visés, et la difficulté croissante à distinguer entre frappe conventionnelle et frappe nucléaire. Cela entraîne un risque d’alerte prématurée, de mauvaise interprétation ou d’escalade incontrôlée."
Cela ne se vérifie pas parce que le vecteur n'a aucun impact sur la doctrine d'emploi des armes nucléaires, qui est par nature connue sans aucune ambiguïté afin justement d'éviter les erreurs de calcul. Le principal effet des vecteurs hypersonique est d'annuler toute velléité de première frappe nucléaire par les puissances n'en possédant pas. Or ce sont bien les USA qui ont réintroduit la possibilité de première frappe, et personne d'autre.
Enfin, la Russie ne présente toujours pas de menace pour l'Otan. C'est l'Otan qui est aujourd'hui une menace pour la terre entière.
Merci beaucoup pour ce travail passionnant !
Sentiment mitigé d'une dissuasion heureusement à peu près préservée par des gouvernements responsables, mais si fragile aujourd'hui...
La dépendance de la crédibilité de la dissuasion à des éléments de maîtrise du spatial, des communications et des moyens conventionnels hypersoniques es est un élément dont je n'avais pas pris toute la mesure. C'est en effet un chantier européen important !